![]() Autre sites à consulter également
Autre sites à consulter également
Stalag XVIII A
AVANT
PROPOS
Le récit qui va
suivre, est un survol des événements qui
ont marqués la vie d''Edilbert.
Nous faisons comme ci le texte était écrit par lui-même.
Ce n'est pas si
simple. Le fait de narrer des faits que l'on n'a pas vécus soi-même ne facilite
pas la rédaction par un tiers.
J'écris malgré tout d'après les anecdotes entendues depuis plus
de cinquante ans que je vis avec lui.
Je vous demande
seulement un peu d'indulgence.
Peut-être m'y
remettrai-je un jour pour développer mon récit plus en détails et de ce fait
plus compréhensible pour ceux qui le lirons.
Arlette
Ce 26 Janvier 1916, depuis deux ans déjà, le canon
tonne un peu partout dans le Nord-Est de la France. Nous somme à, à peine un
mois de l'offensive la plus meurtrière de la guerre 1914-1918. Je fais allusion
ici à la terrible bataille de VERDUN qui va commencer le 21 février très
exactement et coûter la vie à des milliers de combattants français et allemands.
Ce jour donc, l'événement local se présente sous la
forme, si l'on peut dire d'un grondement assourdissant qui affole aussi bien
les gens que les animaux du fait surtout que la nuit est tombée depuis quelques
heures déjà. Les chevaux hennissent dans leurs écuries, les vaches meuglent
dans les étables, tandis que les chiens,
la queue entre les pattes, hurlent à la mort. Ceci mentionné d'après les récits
qu'ont fait les témoins de cet événement; dont mes parents.
Ce bruit qui fait trembler portes et fenêtres est
produit par un ballon dirigeable du nom de son inventeur le Comte Von Zepplin.
Il devait être le seul de toute la durée de la guerre à survoler la région. Je
dois ajouter que cet appareil allemand servait pour des missions de reconnaissance
et qu'il n'en existait que très peu de spécimens.
Personnellement, je ne me souviens pas, étant âgés d'à
peine quelques heures. J'arrive dans une famille composée de sept frères et
sœurs dont l’aîné est âgé de quatorze ans. L'année suivante, une petite sœur
viendra grossir cette famille déjà importante.
Les lois sociales en faveur de la famille n'existent
pas encore. Il faut s'organiser, très tôt, les aînés sont placés dans les
fermes des environs où, en échange de travaux parfois très durs, ils peuvent
prétendre recevoir une nourriture acceptable. L'aîné des sœurs, âgée d'une
dizaine d'année, doit aider aux tâches ménagères, s'occuper de ses jeunes
frères et sœurs et aller au lavoir laver les vêtements et le couches de
ceux—ci. Il va sans dire que l'école communale est fréquentée de façon
sporadique. Moi-même, je n'échappe pas à cette règle, je ne quitte pas la ferme
familiale, mais je ne suis pas favorisé pour autant. Il faut faire paître dans
les prairies environnantes les trois ou quatre vaches dont le lait vendu au
laitier rapporte quelqu'argent qui sert a nourrir la maisonnée..
A la maison, il faut s'organiser. Une couturière vient un jour par semaine pour confectionner
des culottes pour les garçons et des robes ou des manteaux pour les filles ainsi
que des chaussons à partir de couvertures récupérées sur les champs de
batailles. Nous ne songeons pas à envier nos voisins car la pauvreté est
générale, mis à part quelques exceptions. Les familles nombreuses sont
largement représentées. Dans la plupart des foyers il faut tirer parti de tout,
ne rien laisser perdre. Très tôt, je dois ,
apprendre le dur travail de la terre et apprendre a conduire les
chevaux, aider aussi les fermiers voisins qui eux aussi ont besoin de bras.
C'est ainsi
que les années m'amènent à ce jour d'octobre 1936 où, à l'appel sous les
drapeaux, je dois quitter cette vie qui fut la mienne jusque l'âge de vingt
ans.
Me voilà donc parti, nanti de quelques affaires
personnelles serrées dans deux musettes portées en bandoulière, en direction de
TALUS où je dois prendre le C.B.R, dont le confort de ses banquettes de bois
laisse beaucoup à désirer dans des wagons qui n'ont jamais entendu parler
d'amortisseurs !…..Direction, EPERNAY, que je découvre pour la première fois,
avec ses rues pavées dépourvues d'herbes folles comme j'avais l'habitude d'en
voir dans nos villages. Sur les
trottoirs, des dames en toilettes, jamais vues non plus à SOIZY, se pressent
vers les magasins ou leurs domiciles.
En gare je prends l'autorail en direction de REIMS à travers les vignes et la forêt de la
montagne de REIMS parées de leurs couleurs d'automne. En gare de cette même
ville je prends le train qui doit me conduire à MOURMELON, ma destination.
Là c'est la
découverte du camp et ses casernes où je dois séjourner deux longues années. Je
suis loin d'être seul nouveau Nous sommes pris en main par des militaires dont
nous devrons par la suite apprendre les grades sous l'œil goguenard des
anciens…).
Le premier souvenir marquant, c'est le passage sous la
tondeuse du coiffeur. Ah ! celui-là, il doit être payé au poids car il ne
laisse pas beaucoup de cheveux sur la tête.
Ensuite c'est l'attribution des effets militaires.
Nous avons tout d'abord les treillis écrus que nous aurons la plupart du temps
sur le dos pour effectuer les corvées car nous allons en avoir des corvées (…)
Nous n'en manquerons pas. Suit la tenue de drap que nous enfilerons pour les marches, l'exercice ou la
garde. Une deuxième tenue, si mes souvenirs sont exacts, destinée à faire bien
lors de la visite du Colonel ou pour aller en permission. Pour ce dernier
emploi elle n'est pas prête d'être usée !.
Étant affecté dans un régiment de Zouaves, le 8° très
exactement, nous recevons une large bande bleue qui nous tient lieu de
ceinture. Il va nous falloir apprendre à la rouler autour de notre taille. pour
ce faire, il nous faut coincer l'extrémité dans une porte et tourner sur nous
mêmes pour la mettre en place. Les bandes molletières devront, elles aussi,
être roulées et déroulées, cela le plus rapidement possible. Après les
accessoires indispensables à la vie de tous les jours, viennent enfin les
godillots à clous qui nous feront bien souffrir lors des inévitables marches.
Ah ! j'allais oublier, nous recevons la traditionnelle chéchia sans laquelle un
zouave ne serait par un zouave.
Lors de l'installation dans la carrée, on nous montre
a placer tout cela correctement sur une boîte à paquetage que nous avons reçue
pour ranger nos papiers personnels sous clé,. Celle-ci est placée sur une
étagère au dessus de la tête du lit, nos vêtements pliés soigneusement au
dessus. Ils ne doivent pas déborder…sinon on risque de les retrouver éparses
sur le lit et il n'y a plus qu'à recommencer. Cette boite, soit dit en passant,
me suivra partout pendant des années. Je ne m'en suis jamais séparé.
Commencent ensuite les interminables
"classes". Dans l'infanterie, on marche à pied, c'est connu. Une
deux…une deux…pas facile de suivre la cadence ! et ces ordres aboyés, qui
claquent dans les murs entourant la cour du quartier ! On n'a jamais vu çà ! Il
faut apprendre a saluer, apprendre le maniement d'armes, monter, démonter,
cela, autant de fois qu'on n'aura pas compris la manœuvre.
Les inévitables corvées mettent tout le monde au même
niveau. Le paysan comme le citadin devront apprendre a manœuvrer la pelle et le
balai. le ménage est le lot de chacun de nous. Les pluches font, elle aussi,
partie du programme..
La popote mérite aussi qu'on en parle, elle permet
d'apprécier l'art des cuistots qui confectionnent ? selon leur humeur…..
Un an va s'écouler ainsi au rythme des longues marches
à travers les sapins du camp de Mourmelon parmi les lapins et les chevreuils.
Il y aura aussi des marches qui vont nous conduire au camp de Suippes constitué
après la guerre de 1914-1918 sur les sites des villages détruits par de
multiples bombardements. Le fait d'avoir un capitaine ancien combattant de
Verdun nous vaut de nombreux déplacements, sur les vestiges des furieux combats
qui s'y sont déroulés
Les manœuvres
au camps de Mailly qui ressemble comme un frère à celui de Mourmelon sont,
là aussi, autant d'épreuves d'endurance
car ces déplacements s'effectuent le plus souvent à pied avec un pesant barda
sur le dos.
Les déplacements en camion sont plutôt rarissimes
Les cavaliers sont eux aussi des expéditions, ils bénéficient d'un mode de
transport, ils sont moins éprouvés que les fantassins, mais le soir ils doivent panser et nourrir leurs montures
avant de rejoindre le bivouac avec, en plus de leur barda personnel, rapporter
sur le dos l'anarchement du cheval et le conserver près d'eux la nuit afin de
prévenir tout risque le vol. Les chevaux étant parqués parfois à plusieurs
centaines de mètres, les cavaliers arrivent au campement complètement épuisés
et à cet instant précis personne ne songe a les envier.
Les permissions sont rares et les moyens de locomotion
le sont tout autant. Si on veut avoir des nouvelles des parents ou des copains,
il faut soi-même se mettre a écrire et pour certains, c'est plus une corvée
qu'un plaisir.
Un matin on me demande si je veux conduire une moto.
Je répond, bien sûr, par l'affirmative. suite à cela, et là je pense que si
j'avais refusé, j'y serais allé quand même… on me conduit à un local où
s'affairent des ouvriers, qui se trouve être l'atelier de couture ? ..
Deux femmes sont là avec mission de montrer à coudre à des soldats et je comprends
rapidement que je vais en faire partie (.…) Je me retrouve derrière une machine
à coudre, pas de moto à l'horizon ! Ici, il me faut pédaler.. Nous sommes
quatorze militaires au total. C'est à dire un par compagnie. Il y a du travail
car un seul homme doit ravauder, eh ! oui, l'armée n'est pas riche ! et faire
durer les frusques pour toutes la compagnie, c'est à dire un bonne centaine
d'hommes ? J'apprends à poser des pièces et conserver celles que j'ai remplacé
pour … briquer les armes ! Pour superviser le travail, nous avons un maître
tailleur rigide à souhait, mais alors là, pas commode du tout ! Lorsque nous
avons dans les mains, une tenue d'officier, nous avons intérêt à œuvrer
soigneusement pour que la réparation soit sans faute sinon nous bénéficions des
perles de son vocabulaire sur un ton qui est loin d'être mélodieux….
Octobre 1938, enfin la quille !… Sur un désagréable
fond de menace de guerre. Une poudrière se construit à ALLEMANT Je ne suis pas
gêné pour trouver du travail. Je fais donc la route chaque jour en bicyclette
avec la "gamelle" dans la musette. Ce n'est pas toujours agréable,
surtout pendant ces mois d'hiver.
En mars, le 23
exactement , rappel sous les drapeaux , je ne suis revenu à la vie civile que
pour une durée de cinq mois. Direction MOURMELON encore une fois. je suis incorporé de nouveau
au 8ème régiment de zouaves. Après quelques semaines passées à
MOURMELON nous sommes envoyés dans les
Ardennes, sur le plateau de ROCROI, à la Grande Chaudiere très précisément. Notre tâche consiste à raser toutes les haies qui
cachent la frontière avec la Belgique toute proche et les remplacer par des barbelés en réseaux
et des chevaux de frises. Nous nous heurtons, plus ou moins, à l'hostilité des
habitants du coin. Nous cantonnons, aussi, à un moment donné, à SEVIGNY LA
FORET, dans une grange bardée de planches mal jointes, qui nous laisse
bénéficier (?) de la fraîcheur nocturne.
Nous avons pour voisin, un retraité qui, lui, ne veut pas nous voir en peinture
!
La preuve c'est qu'il a, lui aussi, utilisé
des barbelés roulés autour de son puits pour nous empêcher d'y puiser de l'eau
!! Malheureusement pour lui, nous avons tôt fait de démolir son barrage et nous
puisons à qui mieux mieux sous son regard impuissant et courroucé.
A la mobilisation générale, en septembre 1939, je me
retrouve à FISMES, à CHEZELLE exactement, avec mon unité avec, pour mission,
d'interdire tous les réservistes mobilisés qui arrivent à la gare, (celle-ci
servant de gare de triage), de s'égayer en ville ce qui nous vaut des insultes
et des heurts plus ou moins violents de la part de ces hommes, par tellement
satisfaits d'être là !
Quelques semaines se passent ainsi avant que nous
soyons dirigés vers AY où nous devons cantonner une partie de l'hiver. Nous
dormons dans les dortoirs des vendangeurs, car nous sommes au cœur du vignoble
champenois.
Les vignerons sont très accueillants et la bouteille
de blanc est souvent mise à contribution (…..) on en oublie l'inconfort des
bas-flancs qui nous servent de couches.
Le 20 mars
1940, un contingent, dont je fais partie, est envoyé à VALENCIENNES pour être
incorporé au 11 ème régiment de zouaves cantonné à ONNAING à, seulement
quelques kilomètres de la frontière belge. Ce régiment est composé en majorité
de lyonnais, alors que le 8 ème régiment de zouaves rassemblait l'essentiel de
ses hommes originaires de l'est d la France des alsaciens lorrains notamment.
De cette
période, je n'ai pas conservé de souvenirs marquants si ce n'est que la
discipline n'est en rien comparable à celle imposée en caserne. Les jours se
passent au rythme des inévitables corvées et des parties de belote. Il faut
dire que cette période du début septembre 1933 au 10 mai 1940 sera appelée plus
tard la "drôle de guerre" . Elle est mise a profit par les autorités
françaises et allemandes pour évaluer
les forces en présence et adapter la stratégie qui s'impose..
Ce fatidique 10 mai, ordre est donné de
"monter" en Belgique. L'armée française présente dans sa région
s'ébranle y compris notre division commandée par le Général DAME, Les chars,
l'artillerie et les camions nous précèdent, nous, cavaliers et fantassins.
Nous prenons la direction de MONS. Le début du
parcours se déroule à peu près bien, mais au fur et à mesure que nous approchons de l'endroit
censé situer le front, nous croisons d'interminables colonnes de gens fuyant
vers la France. Tous les moyens de locomotion sont représentés : véhicules
agricoles tirés par des chevaux, voitures automobiles pour ceux qui ont la
chance d'en posséder une, bicyclettes, landaus, tous ces véhicules pleins à
craquer. On y avait entassé toutes
sortes d'objets usuels parfois d'une valeur dérisoire qui pour la plupart se
seront abandonnés dans la nature afin de soulager les chevaux ou les
amortisseurs des autos. Derrière la voiture à moisson on avait attaché les
chiens de la maison qu'il fallait finalement monter dans la voiture les
malheureux ayant les pattes meurtries par ces longues journées de marche. Dans
certaines fermes on avait tué le cochon pour qu'il ne soit pas perdu, car il
fallait tout lâcher avant de partir: les poules, les lapins, les veaux, les
vaches afin qu'ils puissent se nourrir tout seuls.
Ceux qui
avaient tué le cochon avaient chargé la viande, contenue dans des
saloirs, sur les charrettes sans oublier les saloirs de lard (!?). Certains propriétaires de chevaux en avaient
prête à un voisin pour qu'il puisse emmener quelques affaires, or, conduire un
cheval quand on est novice…. ce n'est pas toujours évident !
Il va sans dire que la progression de l'armé n'est pas
des plus aisée. Parfois ll faut stopper le flot de réfugiés pour nous frayer un
passage. Malgré la gravité des événements la plupart de ces gens nous
prodiguent des encouragements. Ceux qui ne sont pas partis nous encouragent eux
aussi du seuil des maisons
Au fur et à
mesure que nous approchons, nous percevons le bruit du canon. Nous atteignons
enfin NIVELLE, puis WATERLOO où nous saluons
l' empereur Napoléon figé sur son socle, c'est dans cette région que
nous prenons position. Pour ma part, cela consiste à creuser un trou profond
qui servira de nid de mitrailleuse et d'abri pour nous les mitrailleurs.

Le temps de ça, les
tirs se sont rapprochés et nous percevons maintenant les crépitements des
fusils et de mitraillettes.
Que c'est-il passé ensuite ? Mes souvenirs sont
confus, ce que je me souviens, par exemple, c’est que les pièces d'artillerie crachent , de
nouveau, toujours plus près et les obus tombent à quelques centaines de mètres
de nous sans nous inquiéter outre mesure. Attendons la suite. Celle-ci ne se
fait pas attendre longtemps ! Les tirs ayant été ajustés les obus commencent a pleuvoir,
tout d'abord juste devant nous puis sur les côtés, puis derrière, dans un
vacarme assourdissant. L'artillerie française derrière nous, s'y met, elle
aussi et les obus déchirent l'air, au dessus de nos têtes. L'ennemi étant
signalé à portée de fusil, ordre est donné d'ouvrir le feu ce qui amplifie le
vacarme. La bataille fait rage. Combien de temps cela dure t-il ? Je ne ma rappelle plus très bien, on est
aveuglé par la fumée des armes. Des hommes tombent des deux côtés. Au bout d'un
certain temps qui nous semble une éternité, les armes se sont tues. Nous
restons tassés dans ce que nous appelons notre abri. Nous n'entendons aucun
bruit. Nous sommes devenus complètement sourds. Peut-être qu'un ordre de repli
a été lancé. Nous n'avons absolument rien
reçu et pour cause.
Nous nous décidons enfin a partir à la recherche de
quelqu'officier ou détachement afin de savoir ce qu'on fait là. Nous sommes
complément hébétés.
Dans notre retraite et là, je n'ai jamais oublié: nous
devons traverser une route, donc à découvert et au moment où nous nous trouvons
au beau milieu de cette route, des rafales crépitent et sans prendre le temps
de compter les balles qui nous ricochent dans les jambes, nous nous jetons dans
les fourrés. Fort heureusement aucun de nous n'est touché. Nous continuons
notre errance à travers bois. Peu à peu d'autres combattants se joignent à
nous. Nous croisons, enfin un capitaine accompagné de quelques hommes. Il nous
regroupe et nous fait récupérer, pour ceux qui ont perdu les leurs, des armes
auprès de ceux qui malheureusement n'en auront plus besoin.
L'ennemi continue sa progression. Sous les ordres de
ce capitaine, nous reprenons positions. Après quelques coups de feu, il nous
faut nous replier. Nous repassons sous le regard impassible de Napoléon, mais
personne ne songe à plaisanter la leçon a été apprise de façon sévère….
L'ennemi ne cesse de nous harceler. Nous faisons notre deuil des encouragements
de la population, la plupart des maisons sont vides et les seules traces de vie
sont les animaux domestiques qui errent autour de celles-ci.
Nous atteignons LILLE où notre division se retranche
dans ses faubourgs. A LOOS, où je me trouve, la défense s'organise, les combats
sont acharnés nos troupes se défendent désespérément. J'ai toujours conservé le
souvenir de ce soldat qui avait quitté son poste parce que son fusil
mitrailleur s'était enrayé : Je vois
encore l'adjudant dégainer son arme et lui posant sur tempe lui intimer
l'ordre expresse de regagner son poste. Ce qui aurait eu pour effet de
l'envoyer à une mort certaine. Plusieurs témoins de la scène firent entendre le déclic de
leurs fusils près à tirer au cas ou l'adjudant aurait mis sa menace à exécution
(!?) Bon gré, mal gré, il n'a d'autre alternative que de rengainer plutôt que
de se retrouver comme une passoire. Vu le dramatique de la situation ses hommes
n'auraient pas hésité une seconde.
Les affrontements durent plusieurs jours et sont
particulièrement meurtriers. Un beau matin, le 31 mai très exactement les
Allemands nous avertissent par haut-parleurs que nous sommes encerclés et que
nous n'avons d'autre alternative que celle de rendre les armes, sinon, ils
menacent de faire parler l'artillerie….
Animé par un sentiment de rage et de désespoir, notre
lieutenant tente de nous rassembler et de nous emmener dans une ultime charge
de défense. Devant le manque d'empressement de ses troupes, il doit renoncer à
son projet qui nous aurait conduit droit
au massacre.
La journée se passe dans un calme incertain. Nous nous
rendons finalement le soir venu. Après avoir passé la nuit sous bonne garde,
nous entamons une longue marche - encore une-
à travers la Belgique par une chaleur accablante. Auparavant, il nous
faut retraverser LILLE. La ville n'est pas belle à voir. Hormis les quartiers
dévastés par les bombardements de l'artillerie allemande, nous ne pouvons
échapper au spectacle des nombreux corps gisant ça et là, toutes nationalités
mêlées. Il y en a à tout les coins de rues, comme autant de témoignages de
l'intensité des combats qui ont eut lieu entre ces murs.
La population civile rentrée chez elle reprend peu à
peu ses activités tout en pansant les plaies laissées par les événements que
vient de vivre le pays. Bien que nous soyons à pied, le ravitaillement ne suit
pas. Nous connaissons pour première fois, les affres de la faim et de la soif
et ce que nous ignorons c'est que ce n’est que le début d’une période
douloureuse. Ces mêmes personnes qui
nous avaient encouragés quelques jours plutôt, conscients de notre souffrance
nous lancent au passage quignons de pain, paquets de gâteaux et autres
bouteilles d'eau. Gestes qui nous vont droit au cœur et qu'on n'oubliera
jamais. Nous n'oublierons non plus cette faim qui nous tiraille du matin
jusqu'au soir et du soir au matin sans nous laisser de répit. Un midi nous
avons reçu un repas et songez que nous n'avons rien mangé jusqu'au lendemain
soir et il faut marcher, toujours marcher (…) Et cette chaleur torride qui nous
dessèche le gosier ! Comme nous passons nos nuits à la belle étoile, la
fraîcheur nocturne à pour effet d'atténuer un peu la soif mais la faim, elle
est impitoyable.
Certains prisonniers avaient, pour économiser leurs
forces jetés leurs vareuses et leurs grosses capotes. Le jour ça va mieux (!?)
mais la nuit, ils sont obligés de se réfugier près de ceux qui ont eu la bonne
idée de conserver leurs vêtements lourds . Nous connaissons un semblant de
repos la nuit alors que nous sommes parqués dans les prairies, nombreuses en
Belgique mais la faim nous tient éveillés la plupart du temps à tel point que
lorsque nous reprenons la route, nous sommes tellement épuisés que lors des poses accordées par nos gardiens,
nous nous laissons tomber à même le bitume avec le besoin insurmontable de dormir
là, à même le sol. Les imparables "roust ! ..shnell..", accompagnés
parfois de moults coups de crosses dans
les côtes, nous obligent a reprendre la marche harassante qui nous même on ne
sait où .
Nous atteignons ainsi Maastricht ou Maëstricht, peu
importe l'orthographe nous n'y prêtons pas attention. Nous voici à nouveau
parqués et nous restons quelques jours. La nourriture est distribuée avec
beaucoup de parcimonie – dame il y a beaucoup de monde à nourrir…
Nous goûtons au climat des Pays-Bas : la journée il y
fait une chaleur écrasante tandis que la nuit est très froide. Nous sommes
obligés de nous serrer par trois ou
quatre sous la même capote pour partager un peu de notre chaleur. A quatre
heures du matin, nous sommes debout a taper des pieds pour essayer de nous
réchauffer. Il faut dire aussi que nous dormons (?) à même le sol.
Un matin, nouveau départ, direction AIX –LA-CHAPELLE.
Des trains nous attendent avec leurs wagons à bestiaux. Ils seront bondés ! A
l'intérieur, il y fait une chaleurs étouffante et la faim et la soif nous tiraillent
toujours autant. Un peu de baume, cependant, sur notre misère : des personnes
dépendantes d'un organisme humanitaire, vont de wagons en wagons pour nous
passer quelques paquets de biscuits et des bouteilles d'eau. Contrairement à ce
que nous craignons, la population allemande ne nous manifeste aucune hostilité.
Lorsque nous avons traversé les villages avant AIX-LA-CHAPELLE les gens
donnaient de l'eau au passage tout comme en Belgique.
Le voyage en train est, lui aussi, très inconfortable
et éprouvant. Pendant des heures interminables et dans des conditions physiques
déplorables nous roulons à travers l'Allemagne pour finalement débarquer à
KAISERSTENBRUCK au Autriche. Nous descendons dans une immense gare de triage,
comme celle d'Aix la Chapelle, pleine à craquer. Dans cette multitude de
visages inconnus, hirsutes sur lesquels se lisait l'immense fatigue, j'ai
l'agréable surprise de rencontrer un prisonnier qui, comme moi sort de SOIZY.
Nous n'avons guère le loisir d'échanger que
quelques mots, car après avoir reçu un peu de nourriture nous sommes
orientés vers des destinations différentes. Pour ma part, je suis embarqué dans
un camion bondé, lui aussi, qui nous emmène par des routes de montagnes
cahoteuses à souhait.
Finalement, la caravane de camions, car il y en
a, je ne sais combien, j'avais autre
chose à penser qu'à compter - nous amène
dans un stalag, le XVIII A, très
précisément constitué de baraques en planches. Nous sommes le 10 juillet. Là, enfin,
il est possible de faire sa toilette dont nous avons grand besoin. Nous
avons, à défaut de nourriture convenable, les douches à volonté (…) Le stalag
récemment construit, les baraquements et les barbelés qui l'entourent, a été
installé à EISENERZ, au pied de la montagne de fer et nous ne tarderons pas a
savoir pourquoi ( …) Nous nous trouvons dans le Steiermark, province
autrichienne.
Nous sommes immatriculés, je reçois pour ma part le
numéro 62931 désormais, nous ne serons appelés que par celui-ci. Nos vareuses
et capote reçoivent un K.G. dans le dos, peint en blanc.
La cohabitation s'installe. La discipline aussi. Cela
s'impose, malgré qu'on l’admette difficilement, parce qu'il y a parmi nous des
fortes têtes qu'il faut contrer. Ces fortes têtes se révéleront plus tard et nous aurons tout le temps pour
l'apprendre, être des meneurs toujours à l'affût d'un acte de malveillance
voire même de sabotage. Ce qui la plupart du temps aura pour effet de nous
perturber l'existence déjà durement éprouvée.
Toutes les régions de France sont représentées. Il y a
là des berrichons des Normands, des Miladious, des Chtis et de Parisiens Ces
parisiens, il y en a de deux sortes : celui qui, toujours tiré à quatre
épingles, qui ne parle pas à tout le monde ou s'il le fait, c'est avec beaucoup
de suffisance quand, pour paraître plus intelligent que toi, te pose des
questions …idiotes !? Il y a par contre l'autre parisien dont la gouaille et la
bonhomies te mettent tout de suite à l'aise. Il va falloir faire avec tout ce
monde

Très vite nous apprenons ce que l'on attend de nous.
On ne va pas nous laisser a rien faire! Ben tiens !…
Nos journées vont se dérouler sur un rythme immuable.
Le matin, nous recevons un quart de malt fait à partir d'orge grillé en guise
de café et un quignon de pain gris accompagné d'un petit morceau de margarine ?
! Il nous est bien précisé que ce que nous recevons est la
ration journalière (! ?). nous avions
tellement faim que le croûton a disparu
dès le matin (…) Donc, dès le matin, accompagnés par des sentinelles nous
partons par groupes de dix, douze, je me souviens plus très bien, en direction
de la montagne qu'il nous faut gravir étage par étage pour travailler à
l'extraction du minerai.
La mine, à ciel ouvert, s'échelonne sur une trentaine
d'étages de 24 m chacun. Nous devons en
gravir une bonne partie à pied. Pour ceux qui vont travailler aux étages
supérieurs, un funiculaire fait la navette jusqu'à la cime de la montagne.
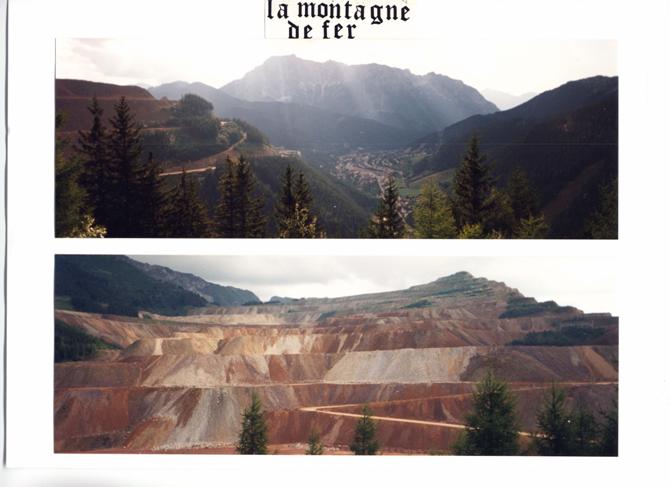
A chaque étage il y a des artificiers qui à l'aide de
marteaux piqueurs percent des trous dans la roche afin d'y placer des charges
de dynamite, ces charges sont reliées par un réseau électrique et, toutes les
trois heures environ, nous devons nous nous abriter et nous avons ainsi 20
minutes de repos pendant que les explosions arrachent d'énormes blocs de
minerai sur tout le flanc de la montagne. A la suite de cela, des hommes armés
de barres à mine descendent en rappel le long des parois en sondant celles-ci
pour décrocher d'éventuels blocs de roche qui menaceraient de tomber sur les
ouvriers travaillant au dessous. Il y a sur les chantiers des locomotives
destinées a tirer les wagonnets que l'on
a hissé en pièces détachées jusqu'à leur niveau de chantiers pour être
assemblées sur place. Notre travail consiste a charger le minerai dans ces
wagonnets qui le mèneront dans un concasseur pour être réduit en petits
morceaux qui seront déversés directement dans les hauts fourneaux au pied de la
montagne. Certains de ces blocs de minerai devront, de nouveau , afin de
pourvoir les charger, être dynamités. Au fur et à mesure que la parois
s'éloigne du fait de l'extraction il nous faut déplacer les rails et les
remettre plus près du lieu des travaux
Nous déplaçons les rails en fait, les aiguillages et dès que nous
avons terminé, nous pouvons regagner le camp et cela même en début d'après-midi. Inutile de dire que la
manœuvre est menée rondement.
Près des haut-fourneaux, se trouve une briqueterie qui
utilise les déchets, rejetés après les coulées, pour la confection des briques.
De temps à autre, je travaille à la fabrication de ces dernières. Mon rôle
consiste à la surveillance de la presse. Celle-ci, trop chargée, écrase les
briques ou si au contraire elle n'y est
pas assez, les briques ne sont pas suffisamment pressées. Ce sont vingt minutes
d'attention contre vingt minutes de pose. C'est ainsi toute la journée. Aucun prisonnier ne travaille aux
haut-fourneaux, ce sont des civils qui s'adonnent à cette tâche. Ils doivent
approvisionner les foyers 24 heures sur 24 tandis que tout au tour des
cheminées l'eau coule en permanence afin de les refroidir.
Il y a une coulée
toutes les six heures. Le fer en fusion de couleur blanche coule à une
température de 1500 degrés, 1700 lorsque le minerai est additionné de quartz.
Le jet est dirigé vers des auges métalliques. Sitôt la coulée terminée on
arrose à grande eau pour décoller la fusion des parois des auges. Inutile de
dire que le local où à lieu la coulée est dépourvu de toit, afin de permettre à
la vapeur qui se dégage de s'évacuer. Les hommes sont torse nu et ne boivent
que du lai à longueur de journée.
Une nuit, de violentes détonations nous font sauter de
nos couchettes. Sur le moment nous pensons à un bombardement. Nous apprenons
par la suite qu'il s'agit en fait de l'explosion d'un haut-fourneau dans un
vacarme assourdissant comparable à l'éclatement de bombes larguées à partir
d'avions.
Le matin, lorsque nous montons à la mine, nous
découvrons l'ampleur des dégâts. Le haut-fourneau éventré laisse voir ses
entrailles et est complètement vidé de
son contenu en l'occurrence le métal en fusion qui s'est déversé alentour sur
les rails qu'il a emprisonnés en refroidissant. Il faut, pour les
dégager découper le fer à l'aide de chalumeaux.
Il nous faut, de nouveau , installer des rails pour accéder
au haut fourneau restant debout.
Notre régime alimentaire nous laissera, j'en suis
certain, un souvenir impérissable. Le soir au retour de la mine nous recevons
en tout et pour tout une louche de rata à base de rutabagas que nous avalons
avidement parce que le morceau de pain du matin est bien loin (…) Le lendemain
matin malgré notre fringale, nous nous efforçons de conserver la moitié de
notre ration de pain que nous mangerons le midi. Oh ! elle n'est pas grosse !…
Elle tient facilement dans la poche ! Nous percevons bien quelques marks en
guise de salaire mais ils ne nous servent à rien parce que nous ne trouvons
rien à acheter.
Il se passe ainsi des jours et des jours, l'air de la
montagne nous creusant impitoyablement l'estomac. Certains trouvent le courage
de plaisanter sur le fait que leurs vêtements s'élargissent ? …, au point
qu'ils nagent dedans. D'autres se sentent libérés des inconditionnelles crises
de foie qu'ils connaissaient autrefois, dans la vie civile.

Il nous arrive parfois, en dormants , de rêver devant
une grande marmite comme celles que nous avions l'habitude de voir dans l'armée
française et une grande louche plongeant dedans pour remplir notre gamelle à
ras bord . En songe, on voit un soldat français et non un vert de gris comme
ceux qui nous servent ces affreux rutabagas, manœuvrer cette grande louche.
Mais ce n'est que rêve … Nous y pensons souvent à cette popote de l'armée
française sur laquelle nous faisions la grimace ! Elle n'était pas toujours
délectable, même la plus mauvaise, on donnerai cher pour l'avoir aujourd'hui
(…)
Encore un mot sur la faim que nous subissons
actuellement. Pour nous rendre à la mine nous devons traverser la petite ville
d'EISENERZ. Nous osons, mais oui, nous osons fouiller les poubelles (…) à la
recherche de tout ce qui peut être mangé.
Quelques épluchures de légumes – pas de pommes de
terre, l'Allemagne tout comme l'Autriche
connaissent la disette et il est interdit d'éplucher les pommes de terre avant
de les cuire par mesure d'économie. Nous récupérons parfois quelques feuilles
de salade, de chou, qui, bien lavées, seront englouties illico. Voyant ça, les
ménagères nous déposent quelquefois une salade entière accompagnée d'une fiole
d'ersatz de vinaigre pour nous permettre de l'accommoder. Comme quoi, la haine
n'habite pas forcément tous les cœurs. Cela dure ainsi plusieurs mois, le temps
que les communications soient établies avec la France. A partir de là, de temps
à autre, un colis de la Croix Rouge Française nous apporte un plus, il faut sagement
faire des réserves pour les jours à venir. Viennent ensuite des colis de la
Croix Rouge Américaine. Je ne me souviens plus si ça s'appelle comme ça, c'est
de toute façon, un organisme humanitaire. Quelquefois un colis de la famille,
des parents nous parvient. On s'organise avec les moyens du bord. On peut dire
que l'on mange à peu près convenablement. Ce n'est pas encore ça, mais on a
connu pire.
Par les colis
que les gars reçoivent de leurs familles on identifie les ressources de chaque
région de France.
Par exemple,
ceux originaires de la Thièrarche reçoivent des maroilles, les Sarthois, des
rillettes, ceux de la région d'Agen , des pruneaux et je pourrais en citer bien
d'autres encore. Nous ne remercierons jamais assez la mère, l'épouse ou la tante
qui, malgré les privations auxquelles elles sont confrontées, arrivent a
confectionner ces précieux colis accueillis avec la joie que l'on devine
aisément.
Selon la composition du notre colis qui ne nous est
remis qu'après avoir été ouvert par nos gardiens, nous faisons des échanges
entre compagnons d'infortune. Malgré les conditions précaires dans lesquelles
nous nous trouvons nous sommes un peu moins épuisés et le moral repart d'un
coup.
Un fait mérite d'être signalé et il n'est pas des
moindres. Étant affamé donc affaibli, cela nous vaut une invasion de poux et
punaises. Pour lutter contre ces dernières nous devons laisser la lumière allumée toute la nuit, ces sales
bestioles ne sortant de leurs cachettes qu'à la faveur de l'obscurité. Les poux
il y en a partout, dans les couvertures, dans les fentes de nos baraquements.
Nos vêtements en sont grouillants, nous devons les plonger dans de grandes
bassines d'eau bouillante et lorsqu'une fois sec nous les renfilons, il y en a
encore dedans (…) Ce n'est qu'après de sévères séances de désinfection que nos
geôliers viennent à bout du fléau.
Dès le mois d'octobre, la neige recouvre la montagne
de son blanc manteau. Le matin en arrivant à la mine il nous faut déblayer les
rails pour que la loco puisse circuler avec ses wagonnets. Il fait déjà très froid aussi bien là-haut, que
dans les baraquements peu adaptés à la
rigueurs du climat. Comme moyen de chauffage nous avons un gros poêle à sciure
trônant au milieu de la piaule. Nous
nous débrouillons aussi, pour l'approvisionner en coke. Ce combustible servant
a alimenter les hauts-fourneaux, il y en a toujours d'énormes tas à proximité de ceux-ci. Le
soir, en descendant de la mine nous subtilisons chacun notre morceau sous l'œil
plus ou moins complaisant de nos sentinelles.
Une fois arrivés à la baraque, gare à celui qui n'a
pas apporté son moellon. Il n'est pas félicité, c'est le moins que l'on puisse
dire ! Le lendemain il a intérêt à faire comme les autres. Bien bourré, de
coke, le poêle est parfois chauffé à blanc, ce qui diffuse une chaleur
bienfaisante dans notre légère baraque pas tellement adaptée aux hivers rigoureux que connaît la
montagne autrichienne. Le coke dont il est question arrive en vrac par wagons et
ce sont nous, les prisonniers qui les déchargent, ce qu'il faut faire sur le
champ, même s'ils arrivent à 8 heures du soir. Il y a des wagons de 22 tonnes
pour décharger lesquels nous ne mettons pas moins de 6 heures. Il y en a d'autres qui font 14
tonnes là, il faut évidemment moins de temps. Tout dépend aussi selon que le
wagon aie une ou deux porte .Ceux qui n'ont qu'une porte nous obligent à aller
chercher la cargaison tout au fond pour la ramener vers la sortie. Ceux qui au
contraire possèdent une porte à chaque bout sont bien vite déchargés. Ceux
d'entre nous qui ont vidé leur wagon les premiers vont aider ceux qui n'ont pas fini. Le travail terminé, quelques
fois tard dans la nuit, nous recevons un morceau de pain avec un accompagnement
de remplacement du nom d'ersatz commun en cette période de guerre. Après cela
nous rentrons au camp et le lendemain nous ne montons pas à la montagne. Nous
restons au camp. Nous avons le droit de nous reposer.
Une mise au point s'impose ici : Par crainte des
bombardements américains, toutes les lumières doivent être camouflées, chez les
civils. Par contre le camp reste illuminé toute la nuit. Cela certainement
selon des conventions internationales.
Un matin , il
avait gelé à – 30 ° le froid nous
transperce alors que, comme chaque jour nous montons à la mine. Arrivés en
haut, impossible de travailler. Tout ce que l'on touche nous colle aux mains et
les machines refusent de démarrer. Nos
gardiens nous ramènent au camp et c'est la seule journée en quatre
hivers que nous ne puissions travailler. Il y a bien d'autres jours où la
température étant à peine plus élevée, que nous aurions aimé rester au chaud,
là aussi.
L'ambiance est telle parmi les prisonniers, que sur le
chantier, c'est à qui en fera le moins. Il ne faut pas se forcer a travailler
pour l'ennemi. Ceci pour éviter les sarcasmes des meneurs dont j'ai déjà parlé.
Lorsque notre chef de chantier s'évertue à nous commander un travail, nous faisons tout pour ne pas
comprendre, même si nous avons parfaitement compris. Il nous arrive souvent
d'assister au spectacle du chef de chantier prendre l'outil, et mimer le
travail a accomplir, sous le regard goguenard de l'assistance. Nous ne
cherchons pas à parler allemand sous peine de se faire taxer de collaborateur.
Malgré cela nous nous soutenons
mutuellement entre prisonniers, la situation est déjà assez compliquée sans
qu'il en soit autrement. Il nous arrive parfois, en quittant le chantier le
soir, d'enlever nos capotes et de nous asseoir dessus et comme si c'était une
luge dévaler les pentes neigeuses tandis que les récifs environnants
répercutent à l'infini les échos des cris désespérés de nos gardiens auxquels
nous avons échappé. Les parties de belote créent, elles aussi, des liens entre
compagnons d'infortune.
En 1943, un matin alors que, comme à l'accoutumée nous
partons pour la mine, un étrange cortège nous emboîte le pas. Ce sont de
pauvres hères vêtus de "pyjamas" rayés, avançant péniblement, la tête
baissée. Ils sont encadrés par des S.S. l'arme au poing prêt a tirer à la
première occasion. Nous comprenons très vite qu'il vaut mieux garder ses
distances et ne pas trop regarder où il ne faut pas (….) . Il en sera ainsi
chaque jour car ces prisonniers, que
nous appellerons plus tard des déportés sont employés à la construction
d'un monument dans la montagne pas très loin de la mine d'où nous les voyons
monter des pierres nécessaires à la construction de ce monument. Du matin
jusqu'au soir on les voit monter et descendre continuellement, sans arrêt. Nous
nous demandons qui sont ces gens ? Quels crimes ont ils commis pour mériter un
tel châtiment ? Nous n'aurons la réponse
que beaucoup plus tard, comme nous n'avons pas de contacts avec l'extérieur, en
l'occurrence la population civile. Selon comme le vent est tourné, il nous
amène des relents insupportables de chair brûlée.
Nous apprendrons après la fin de la guerre que l'autre
côté de la montagne, c'est à dire en plein nord, se trouve un camp semblable au
nôtre mais avec, en plus, des fours crématoires qui nous envoient si
généreusement leurs fumées. Il s'agit, si mes informations sont exactes d'une
annexe du sinistre camp de MAUTHAUSEN. Nous
nous habituons tant bien que mal à la vue de ces lamentables défilés et
se tenir le plus loin possible des sinistres geôliers qui, eux, tiennent toute
la route. Un simple regard de ces fauves vous glace l'échine
Un soir alors que nous rentrons au camp par petits
groupes, nos sentinelles ayant peu à peu relâché leur vigilance et pour cause,
nous croisons un SS en vélo. Je ne trouve rien de mieux que de dire à mes
camarades " Attention c'est un SS". Comme s'il ne l'avaient pas vu
eux même ! La réaction ne se fait pas attendre : Il descend de son vélo, la
mine assassine et se dirige vers notre groupe et me demande " Uber laga ?
Uber laga ? !! Je comprend parfaitement ce qu'il veut , mais je continue mon
chemin, pensant m'en tirer comme ça . l'individu naturellement nous emboîte le
pas. Je ne suis pas fier du tout, de même que mes camarades. C'est le moins que
l'on puisse dire. J'avais raté là, une bonne occasion de me taire. Arrivé au
stalag, le policier demande le commandant auquel il fait rageusement son
rapport. Quoique ne comprenant pas
l'allemand, je vois bien que ce ne sont pas des fleurs !! L'intéressé me
traduit ses propos : Il prétend que je l'ai insulté. Ce que je nie
farouchement. Le "plaignant" demande une punition sévère. Ce que le
commandant lui promet. Le visage fermé
de celui-ci n'augure rien de bon pour moi. Je comprend par la suite que son
attitude sert plus a donner satisfaction au plaignant dont il souhaite se
débarrasser au plus vite, que pour me faire craindre une sanction qui ne
viendra jamais. Après le départ du
S.S. l'interprète passe dans toutes les chambres pour nous
recommander de bien faire attention et éviter le plus possible les S.S. car
cela pouvait être dangereux pour nous . Ouf ! L'alerte avait été chaude et je
ne suis pas près de l'oublier.
Le lendemain, comme le chantier des déportés avec
leurs terribles geôliers se trouve à proximité de la mine où nous
travaillons, nous refusons de nous rendre dans leurs parages et demandons a ce
que notre lieu de travail soit déplacé . Notre requête nous est accordés sans
difficulté.
Je dois signaler au passage que notre travail est un
peu rémunéré. Oh ! Pas cher ! Seulement quelques Reich Marks qui, pour l'instant, ne nous
servent à rien, attendu qu'on ne trouve rien à acheter. La campagne de Russie,
en 1941 va nous permettre d'en utiliser. Les armées allemandes, lors de
l'invasion de l'Ukraine, font main-basse sur tout ce qu'elles trouvent. C'est
ainsi que nous avons la possibilité d'acheter des pommes de terre et nous nous
débrouillons pour les faire cuire sur le
poêle . Il va sans dire que ces patates remplacent avantageusement l'affreux
rata de rutabaga qui nous est servi le soir. La plupart du temps, il va à la
poubelle.
En revenant du travail la journée terminée nous
passons près des wagons bien gardés où sont entreposées les fameuses pommes de
terre et certains ne résistent pas à l'envie de remplir leurs musettes et là
tout dépend de l'humeur des sentinelles, les resquilleurs prennent quelquefois
un coup de pied aux fesses et si ça se trouve, le lendemain, on peut emplir sa
musette sans risque. Tout dépend sur quel gardien on tombe.
1943 est l'année de la capitulation de l'armée du maréchal
BADOGLIO qui, après avoir fait partie des forces de l'Axe Italo-Allemand,
s'était retournée contre les forces du Reich pour finalement capituler, devant
celles-ci. Un grand nombre de combattants italiens fut fait prisonnier. Nous en
voyons arriver dans notre stalag déjà largement peuplé. Tout comme nous, lors
de notre arrivée, il doivent se contenter de la rare nourriture qui leur est
distribuée. Eux aussi, tout comme nous, à une époque pas très éloignée, ont
faim ! Il n'hésitent pas, eux aussi, comme nous
l'avons fait, a faire les poubelles (…). Il avalent nos rutabagas, même
s'ils sont aigres (!?). il va sans dire que certains prisonniers impitoyables
ne ménagent leurs quolibets ! Ils sont aussi très mal vus par les sentinelles
allemandes. Combien de fois entendons nous les fameux " raust ! snell !
" " Aventis macaronis" et autres expressions dont nous ne
comprenons pas toujours le sens. Nos geôliers leur mènent la vie dure c'est le
moins que l'on puisse dire.
Nous, les Français ne sommes pas trop mal vus, à part
les quelques indisciplinés qui veulent se montrer plus forts que les autres.
L'âge de nos gardiens varie au fils des ans. Au début de notre captivité nous avions des hommes en
âge d'être soldat, mais la guerre de Russie, tout comme les tentatives de
débarquement en Angleterre sans parler de la campagne d'Afrique et ensuite
d'Italie, ont coûté à l'armée du Reich beaucoup de vies humaines qu'il faut
remplacer. C'est pourquoi nous nous trouvons avec des sentinelles âgées de 40,
50 ans et parfois plus. Ce sont, de toutes façons, des hommes qui n'ont pas
demandé à être là. La guerre est aveugle et cruelle pour tout le monde. Fin
1943, début 1944 nous ne sommes plus accompagnés pour aller au travail. Nous
sommes comptés au départ ainsi qu'au retour. L'idée de nous évader ne nous vient même pas à
l'esprit. Tout d'abord, du fait que la région est truffé de SS et de policiers
de tout poil. Nous en croisons à tout bout de champ. Deux de nos camarades
osèrent, cependant, tentent la belle. Ils furent repris deux jours plus tard
après avoir parcouru 6 ou 7 kilomètres (…) Dans une région montagneuse comme
celle où nous nous trouvons, à moins d'être alpiniste chevronné, il est
pratiquement impossible de s'évader. C'est
Alcatraz !
Le 6 juin 1944, nous apprenons que les américains sont
débarqués en Normandie. Je ne vous dirai pas comment les nouvelles des différentes phases de la guerre
nous parviennent n'en sachant rien moi-même, sinon que les moyens d'information
dont nous disposons sont principalement le bouche à oreille.
Un beau matin de juillet, des camions nous attendent
devant les baraquements. Il nous est ordonné de rassembler nos affaires
personnelles et ensuite d'embarquer dans ces camions. Nous partons ainsi, sans
trop savoir vers quelle destination. Puis, de village en village les camions
s'arrêtent. A chaque arrêt il descend une douzaine d'hommes et nous comprenons
que notre rôle consiste à aider les civils autrichiens, artisans, fermiers qui
manquent cruellement de main-d'œuvre. C'est comme cela que j'arrive à
RATTENBERG , un petit village niché au creux d'une petite vallée. Nous avons à
notre disposition un local que l'on nommera Komando qui doit nous servir de
dortoir.

Dans le village,
parmi les civils il n'y a pas d'hommes valides, tous sont mobilisés ou tués à
la guerre. Les filles doivent aller
travailler en ville en usine ou ailleurs. En revanche les filles de la ville
viennent travailler à la campagne. Les garçons , eux, n'en parlons pas ! dés
l'âge de 10 ans, il sont envoyés dans
des camps d'instruction afin de grossir les rangs de la jeunesse hitlérienne .
Il y a aussi, dans les fermes, de jeunes ukrainiennes que l'on a amenées de
Russie. Dans presque chaque foyer, il y a un handicapé mental quelquefois
physique qui, ne pouvant servir à rien militairement, est placé là pour aider
?…, à de menus travaux.
Il y a là aussi, des
Ukrainiennes âgées de 17 à 20 ans, venant des provinces occupées par l’armée
allemande. Elles ont été enrôlées dans le cadre du S.T. O (service du travail
obligatoire)
Elles apportent leur
aide dans les travaux ménagers à la ferme où je me trouve comme dans toutes les
fermes d’ailleurs.

La ferme où j'arrive, le patron est présent, si l'on
peut dire, car étant trop âgé pour être mobilisé, il doit se rendre chaque jour
à FOHNSDORF pour travailler à la mine de charbon

.
Tout heureux d'accueillir une aide providentielle qui
lui sera bien utile pour la bonne marche de son exploitation, il me reçoit
chaleureusement, conscient des difficultés que nous rencontrons pour nous
nourrir au camp, il tue un mouton et veille à ce que je ne manque de rien. A
partir de ce jour, je sais que je ne souffrirai plus de la faim. Ce ne sera pas
le cas pour mes camarades restés au camp, car les armées allemandes étant contraintes
de quitter la France, les communications sont, comme lors de notre arrivée en
Autriche, de nouveau interrompues. Donc plus de courrier, plus de colis non
plus cela pendant neuf mois environ .et
je me félicite d'être atterri là où je suis !
A mon arrivée dans le village je me trouve avec
d'autres prisonniers de guerre qui travaillent chez l'habitant depuis le début
de leur captivité. Ils n'ont presque pas connu la détention en stalag.
Il va sans dire qu'ils sont parfaitement intégrés à la
vie des villageois (es) . Comme je le disais plus haut, la plupart des
"patronnes" sont seules pour faire tourner l'entreprise et certains
des prisonniers ne se contentent pas d'aider à la bonne marche de
l'exploitation mais se substituent au maître des lieux. Contrairement à nous,
qui arrivons du camps, ils s'expriment aisément dans la langue locale. Ce sont
eux qui nous servent d'interprètes.
Au moment de passer à table, il y a cependant un hic
.. dans ces pays là, on se s'embarrasse pas avec les problèmes de vaisselle.
Sur le milieu de la table, trône un large plat quand ce n'est pas la marmite où
sont réunis la viande et les légumes. Chacun pique à même le plat. Or parmi les
convives, il y a un de ces débiles mentaux, auquel j'ai déjà fait allusion, qui
s'apparente plus à un porc qu'à un être humain et qui s'alimente de façon
approximative. Le premier jour, j'avais tellement faim que j'ai quand même
mangé un peu, mais le lendemain, j'ai fait comprendre que je désirais une
assiette. Des assiettes, cela existe là-bas, puisqu'on m'en donne une à chaque
repas. Certains de mes camarades n'ont pas eu à formuler une telle requête ,
dans certains foyers les assiettes sont présentes sur la table.
Nous sommes donc en juillet et c'est la pleine période
des fenaisons. Heureusement que je sais me servir d'une faux. C'est le seul
moyen de couper l'herbe sur le flanc de la montagne. Une fois sec, le foin doit être descendu à l'aide d'un râteau et
ce, jusqu'à un endroit où on peut accéder avec le chariot tiré par un bœuf et un
cheval. On me demande de conduire l'attelage je veux bien…mais je ne connais
par l'allemand et les pauvres bêtes ne comprennent pas le français…La patronne
me donne quelques leçons et très vite, malgré quelques ratés, je parviens a me
faire obéir de mon attelage et celui-ci
de s'habituer à mon commandement. Une partie du foin sera ramené au village et
engrangé au dessus de l'étable dans laquelle il sera descendu l'hiver par une
trappe prévue à cet effet. Ce qui ne tient pas dans la grange est mis à l'abri
dans des petits bâtiments construits en bois, constitués d'un toit avec des
poteaux pour seuls supports.
Chaque ferme possède ses quelques vaches, un cheval ou
un bœuf, parfois les deux, quelques moutons et un ou deux porcs.
La culture de la terre se limite a un petit lopin sur
lequel on récoltera un peu de blé, de seigle, orge ou avoine et bien sûr les
pommes de terre pour la consommation
familiale. L'été, les génisses et vaches qui n'ont momentanément plus de
lait, qui n'ont donc pas besoin d'être, chaque
jour rentrées à l'étable , sont parquées au flanc de la montagne.
Parquées, c'est beaucoup dire, car il est impossible de planter un pieu dans le
sol rocailleux afin de poser une clôture comme autour des prairies situées prés
du village au fond de la vallée. Pour délimiter la pâture, on se contente
d'abattre un sapin, là où se trouve un éventuel passage, les rochers formant,
ailleurs, une barrière naturelle.
Les étables sont
conçues de telle sorte que l'on peut circuler aussi bien devant que derrière
les bêtes. Les soins sont ainsi facilités pour les nourrir comme pour les
nettoyer. Chose qui n'existe pas dans nos villages en France où les bêtes sont
directement attachées au mur. Un mot encore
au sujet des étables : les vaches attachées naturellement, dorment sur un plancher de
sapin légèrement incliné vers l'arrière et n'ont pour toute litière que des
fines branches de sapin hachées menu, le peu de paille fourni par les céréales
étant réservé pour la nourriture des animaux.
Lorsqu'arrive l'automne, alors que les récoltes sont
engrangées, notre principale occupation consiste à préparer le bois destiné au chauffage
indispensable pendant les longs mois d'hiver. Ce sont les chênes et les hêtres
qui fournirons ce bois. Les sapins seront réservés à l'industrie. Seules leurs
branches serviront, pour les plus grosses, au chauffage tandis que les plus
petites seront utilisées comme je viens de l'expliquer, à la litière des bêtes.
Tous ces arbres, une fois coupés seront glissés ou roulés vers le bas de la
montagne, y compris les branches. Cela jusqu'à un endroit accessible avec le
chariot sur lequel ils seront transportés jusqu'au près des maisons
Octobre, la neige est fidèle au rendez-vous. il faut
"chausser" le bœuf et le cheval
avec des fers munis de crampons et troquer le chariot contre le
traîneau. J'assure les transports avec mon équipage. Je mène le grain au moulin à Fonhsdorf. Je vais
aussi à la mine de cette ville pour ramener du charbon pour différents foyers. Les gens me confient
l'argent pour payer à la mine de même
que je reçois celui du grain au moulin. Au retour, je dois donc rendre les
comptes et la monnaie.
Il n'y a pas d'église
ni d'école à Rattenberg. Les enfants scolarisés doivent se rendre à Fonhsdorf à
pied, chaque jour. Ils ont trois à quatre kilomètres a parcourir le matin et
autant le soir. Avec un peu de chance, ils peuvent profiter du traîneau mais
cela n'arrive pas tous les jours. La neige nous offre le saisissant
spectacle des hordes de cerfs et de
chevreuils que l'on peut compter par centaines, qui, poussés par la faim,
descendent de la montagne pour venir brouter autour des abris que nous avons
comblés de foin au cours de l'été

Le foin m'amène a parler du débile mental qui se
trouve à la ferme. Son travail hivernal consiste a découper menu le foin et la
paille qui seront déposés dans les crèches placées devant chaque animal,
vaches, cheval et bœuf. Donc à longueur de journée, le handicapé lève, abaisse,
inlassablement, une sorte de grand couteau semblable à celui dont se servent
les boulangères en ville pour couper le pain. Cela tout en jetant de temps à
autre un regard idiot dans notre direction provocant quelques railleries,
plutôt malvenues.
Notre travail journalier consiste surtout a enlever la
neige qui tombe presque régulièrement chaque nuit.
Lorsque l'hiver tire à sa fin et que la réserve de
foin s'amenuise, il nous faut aller en chercher dans les petits abris qui ont
servi de mangeoires aux cervidés. Nous puisons ainsi dans le tas, enfin…dans ce
qu'ils ont bien voulu laisser…
Pour accéder à ces réserves, je dois passer plusieurs
fois avec le traîneau vide avant de pouvoir circuler avec le chargement de foin
tant la neige et épaisse.
Dans ces régions lointaines, Noël est la principale
fête de l’année. On en profite pour tuer le cochon. Le menu de Noël se compose de différentes charcuteries et
autres cochonnailles. J'en aurai presqu'oublié les rutabagas (…) La viande sera salée pour être conservée
jusque dans l'été. Le lard sera salé, lui aussi, avant d'être placé dans le
fumoir. Une fois fumé, il sera consommé sous forme de tranches accompagnées
d'une large tartine de pain gris cuit à la ferme. Chacun cuit son pain. Comme
il n'existe pas forcément de four dans chaque maison, les gens s'entraident et
la fournée est parfois constituée du pain de plusieurs familles.
La ferme où je me trouve fait aussi office de débit de
boissons et occasionnellement
restaurant. Il y vient parfois des officiers allemands déjeuner. De ce
fait, le patron a le droit de tuer un bœuf par an. La viande est mise en
conserve dans des boîtes stériles. Je retrouve pour l'occasion le goût de la
viande de bœuf que j'avais plus ou moins oublié.

Je pense quelquefois à mes camarades restés au stalag.
Il doivent connaître de nouveau la faim comme au début de notre captivité.
Depuis le débarquement, pour ceux originaires des régions abandonnées par les
troupes allemandes, il y a belle lurette qu'ils ne reçoivent plus de courrier,
pas plus que de colis, tout comme moi d'ailleurs. Heureusement je n'en souffre
pas trop de part ma situation.
Avec l'arrivée du printemps la neige disparaît peu à peu et nous pouvons reprendre le
travail des champs. Me familiarisant avec la langue locale, je pars souvent
seul au travail car depuis plusieurs mois que je suis là je connais à peu près
tout les endroits où il y a a faire, tout comme mes camarades travaillant dans
les autres fermes.
Tout près de Rattenberg se trouve un camp d'aviation
en bordure duquel sont rangés, soigneusement camouflés, des avions de chasse
qui, apparemment ne sont gardés qu'épisodiquement – le manque d'effectif se
fait sentir, aussi. Parfois nous plantons l'outil au bout du champ et nous
prenons plaisir à grimper à bord des coucous.
On pourrait saboter si on voulais. L'idée ne nous vient même pas à l'esprit . A
quoi bon d'ailleurs ?
Cela suffirait qu'à entraîner des représailles, comme
notre retour au camp par exemple, ce à quoi nous ne tenons pas
particulièrement, cela va sans dire. Pour terminer, je dois ajouter que cet aérodrome
a pour nom Zeltweg qui sera un jour célèbre dans la compétition automobile.
En ce printemps 1945? l'Allemagne s'essouffle. Après de durs combats livrés
contre les troupes française, anglaise et américaines à l'ouest et contre les
armées russes, les forces du III ème Reich sont finalement repoussées à
l'intérieur des frontières allemandes.
Cet à ce moment là qu'un fait nouveau me rappelle les
longs convois de réfugiés vus en Belgique en 1940: Nous voyons arriver
d'interminables colonnes de paysans hongrois qui ont franchi la frontière , pas
très éloignée de Rattengerg, poussés par les armées russes qui envahissent leur
pays. Nous découvrons ainsi leurs chariots à quatre roues avec des sortes
d'échelles qui leurs tiennent lieu de ridelles le tout recouvert de bâches
tendues sur des arceaux de bois. Ces véhicules nous font penser aux wagons
couvert couverts des pionniers de l'ouest américain au XIX ème siècle. Ces
chariots pleins a craquer sont tirés par de petits chevaux hongrois bien sûr,
attelés par deux ou par trois côte a côte . Derrière certaines voitures, tout
comme en Belgique on a attaché une ou deux vaches pour lesquelles le voyage est extrêmement
pénible.
Au dessus de nos têtes , comme ce fut le cas pendant des années, nous sommes
survolés à très haute altitude par des Fortress américaines soigneusement
groupées en triangle qui, selon un itinéraire immuable, parties d'Italie se
dirigent vers l'Allemagne pour déverser leurs cargaisons de bombes sur ce qui
reste des grands centres industriels, ferroviaires ou militaires. Autour des
bombardiers nous assistons au ballet incessant des avions de chasses qui
assurent leur sécurité.
Nous suivons avec beaucoup d'intérêt le déroulement
des événements à travers les informations qui parviennent jusqu'à nous. Chacun,
aussi bien les militaires, que les civils ou nous-même, sentons la fin
prochaine du conflits. Chacun régit à sa manière, mise à part une minorité de
fanatiques qui ne veulent pas regarder la vérité en face en espérant un ultime
sursaut de la "grande Allemagne". Ceux-là sont tout de même assez
rares la grande majorité civile ou militaire en a assez de cette guerre qui
tue, qui ruine et affame toutes les populations.
Le peuple allemand tout comme les autrichiens aspirent
en silence, car il est formellement interdit de s'exprimer publiquement sous
peine de sanctions sévères à un
armistice libérateur qui les délivrera
du joug hitlérien.
Un beau jour de mai, la nouvelle tombe : l'armistice
est signé – à Reims ! – près de chez moi ! Cette bonne nouvelle est accueillie
par une explosion de joie dans notre commando. Nous jubilons à la pensée de
bientôt rentrer au pays. Quelle joie !! cependant, tout le monde ne manifeste
pas la même gaieté. En premier lieu,
notre patron qui s'était attaché à nous les prisonniers, peut-être aussi à
notre travail. Quoiqu'il en soit, il est triste de nous voir partir bientôt et
ce sentiment existe dans la plupart des chaumières.
L'approche des combattants russes étant annoncée, les
villageois rassemblent quelques hardes, de la nourriture et même des animaux,
chiens, chats et même des lapins et s'enfuient dans la montagne. Nous restons
seuls dans le village à déambuler dans les rues un peu désorientés. C'est à ce
moment-là, qu'arrivent des cohortes de soldats russes sales, hirsutes, à la
mine patibulaire. Nous sommes très inquiets quant au sort qui nous est réservé
; quand ils se mettent à nous
rassembler sans ménagements en débitant un charabia que nous ne comprenons pas
du tout. Seul mot que nous arrivons à saisir est kommendantur ! kommendantur
!…..
Oh!..Qu'est que c'est çà ?….on veut nous emmener à la
kommendantur ?…un certain temps, je fais mine de suivre ma "sentinelle
" lorsqu'arrivé à un endroit que je connaît et qui se révèle être une
sorte de labyrinthe dans lequel je suis à peu près sur d'être rapidement hors
de la vue de mon geôlier, je disparaît rapidement dans les ruelles qui me
conduisent à notre dortoir où je retrouve certains de mes camarades avec la
ferme intention d'y rester sagement en attendant la suite des événements
Plus question de promenade. Inutile de risquer
quelques mauvaises rafales de pistolet mitrailleur.
De nos fenêtres nous voyons les soldats russes aller
et venir. On les voit entrer dans les cours, en ressortir, nous nous gardons bien
d'aller voir ce qu'ils font.
A plusieurs reprises, au hasard de leurs déambulations
certains ouvrent notre porte en passant. Parmi l'assistance personne ne bouge.
Après un rapide regard circulaire, les
russes rebroussent chemin à notre grand soulagement.
Quelques heures se passent ainsi avant que le village
retrouve son calme. Les soldats russes semblent s'être éloignés. Nous en auront
l'explication par la suite. Selon les
clauses de l'armistice, l'Allemagne vaincue doit être occupée par les troupes anglaises,
américaines, française et russes en territoire allemand y compris l'Autriche,
où nous nous trouvons, des lignes de démarcations sont tracées. Or, celle qui
sépare l'Autriche en deux se trouve à l'est de Rattenberg, à une distance d'une
dizaine de kilomètres environ. Nous sommes dans une zone occupée par l'armée
anglaise alors que l'armée russe a dût se replier au delà de la ligne de
démarcation tandis que les troupes anglaises occupent une autre région.
A un moment donné un chariot tiré par un cheval, vient
se ranger devant notre bâtiment et un civil nous fait monter à bord de son
véhicule et nous partons, ainsi , à travers les rues du village laissé dans un
état lamentables par les soldats russes !!! Toutes les maisons ont été mises à
sac. Elles sont littéralement vidées de leur contenu ! Balancés à même le sol, dans les cours, dans les rues
gisent à moitié brisés, des meubles, des ustensiles de cuisine, du linge, de la
vaisselle, enfin tout ce que les pillards ont pu trouver à l'intérieur. Je n'ai
jamais vu pareil saccage ! Les villageois redescendus de la montagne tentent de
récupérer ce qu'ils peuvent, et ce spectacle se renouvellera au hasard des
villages traversés.
Nous quittons Rattenberg heureux d'être libres en
songeant à notre pays que nous allons revoir bientôt ; non sans un certain
pincement au coeur surtout pour ceux qui y ont passé ces cinq dernières années.
Il y a même quelques larmes de versées dans certaines chaumières.
Nous sommes conduits, à bord de notre chariot, vers un
camp où des soldats anglais nous distribuent quelques rations qui sont les
bienvenues car la faim nous tenaille de nouveau.
Ensuite on nous fait monter dans des camions qui vont
traverser l'Autriche en direction de l'Italie. Nous passons dans la ville de Klagendurt
avant de rejoindre Villak où nous entrons en Italie, puis c'est Udine avant
d'arriver à Venise où nous restons quelques jours. Nos camions étant rassemblés
a proximité de la mer, nous pouvons nous adonner aux joies de la baignade. Je
ne suis pas près d'oublier mes
prouesses. Alors que je barbote - je ne sais pas nager – porté par les flots,
je m'éloigne peu à peu du rivage, jusque là tout va bien. Au moment de regagner
la plage le courant malin me renvoie toujours vers le large. Je me retrouve avec
de l'eau jusqu'au menton ! C'est à ce
moment-là que deux camarades conscients de mes difficultés me saisissent et
m'aident à regagner la terre ferme.
Ouf !!! L'alerte a été chaude !…. Sans l'aide de mes
camarades, la devise " voir Venise et mourir" risquait de se
concrétiser !… J'ai bien failli explorer l'Adriatique dans ses profondeurs !
Cet incident mis à part, les quelques jours passés à
Venise nous font le plus grand bien car
ces centaines de kilomètres par les
routes de montagnes, dans des camions pour le moins inconfortables, nous
avaient mis les reins en compote.
Toujours à bord de nos camions nous reprenons la route
vers le Sud de l'Italie. Pourquoi ? cela ne nous rapproche guère de la France ?
qu'importe , il faut bien aller là où on nous emmène .
Nous traversons la magnifique plaine du Pô et quoique
n'étant encore qu'au début de juin, la
moisson bat son plein. Nous remarquons aussi au passage le vignoble dans cette
région. Les ceps sont établis en treilles de deux mètres de haut environ ce qui
les différencie des modestes pieds de vignes que nous connaissons en Champagne
et qui ne gravitent pas à plus de 1 m 20 de haut. le climat n'est pas le même
non plus. Ceci explique peut-être cela . Le risque des gelées et moindre dans
cette région d'Italie que chez nous.
J'apprends par la même occasion qui si l'Italie
produit d'excellents crus, elle exporte beaucoup – enfin en temps de paix- le raisins de table.
Nous suivons toujours la côte Est de l'Italie non loin
de la mer que nous apercevons quelques-fois. Quelques villes comme Rimini,
Ancône jalonnent notre route. Nous arrivons à Foggia, sur un immense aérodrome
recouvert de nombreux avions chasseurs
et bombardiers ceux-là même, paraît-il
qui nous survolaient pendant la guerre pour aller bombarder l'Allemagne.
Nos camions circulent à travers le terrain pendant une durée que je ne peux
déterminer. Nous comprenons que le voyage terrestre va se terminer ici pour
nous. Cela va se poursuivre par les airs. Effectivement on nous fait grimper
dans un de ces appareils dont la taille est sans commune mesure avec les
coucous qui nous amusaient à Zeltweg . Je ne sais combien de ces avions sont
pourvus de cette cargaison humaine car c'est de cela qu'il faut parler
plutôt que de passagers : Nous sommes assis à même la tôle
ou le sol, c'est comme on veut, car nous
nous trouvons dans la soute habituellement réservée aux bombes.
Bientôt, un vacarme assourdissant couvre le ronflement
des camions. Ceci pendant de longues minutes avant que nos appareils s'ébranlent
pour finalement décoller. Pas question d'admirer le paysage vu l'absence de
hublots. A peine peut-on apercevoir le sol italien par de minuscules fentes qui
subsistent à la limite des ouvertures par lesquelles sont habituellement
larguées les bombes. Ensuite l'uniformité glauque que nous pouvons apercevoir
nous indique que nous survolons la Méditerranée.
Cela dure ainsi de longues heures. Le voyage n'est
guère plus confortable que dans les camions et nous commençons à nous
ankyloser. Finalement, la baisse du régime des moteurs de notre appareil – un
Libérator – nous indique que nous approchons de notre destination, de même que
les mouvements de l'appareil qui perd peu à peu de l'altitude. Mis à part
quelques "trous d'air" qui avaient quelque peu semé la panique parmi
nous, l'ensemble du voyage ne s'est pas trop mal déroulé
Enfin , nous touchons le sol de France et c'est en
titubant quelque peu que nous le foulons après de longues années d'absence.
Nous nous trouvons sur la base d'Istres, très exactement.
Je ne sais combien les vols réguliers comme celui que
nous avons emprunté comporte d'avions, toujours est-il qu'il déboule des ex
prisonniers de tous les coins, nous sommes je ne sais combien de milliers qui
sont conduits vers des centres d'accueil pour y recevoir des rations
alimentaires, un peu d'argent et même des vêtements et chaussures pour ceux qui
en ont le plus besoin.
En attendant de pouvoir prendre le train qui nous est
destiné nous avons le loisir de faire connaissance avec la cité phocéenne qu'est
Marseille et aussi diriger nos pas vers la Cannebière ou encore le Vieux Port,
dont nous avons si souvent entendu parler par nos camarades d'infortune
Marseillais.
Enfin, pour ma part, je prends le train à destination
de la Champagne qu'il me tarde de retrouver. De cette dernière partie du
voyage, il y a peu a dire; Arrivé en gare d'Epernay j'ai le plaisir de
retrouver un gars de Soizy-aux-Bois et après quelques formalités, nous sommes
pris en charge par un automobiliste qui nous ramène au pays et nous apprenons à
ce moment à que nous sommes les deux derniers a rentrer au foyer. Nous sommes
le quinze juin 1945.
Il va sans dire que je découvre un certain changement
parmi la population. Les parents sont un peu plus voûtés qu'il y a cinq ans,
les frangins se sont quelque peu empâtés et commencent à grisonner. Quant à mes
neveux n'en parlons pas. Ceux que j'ai quittés bambins sont devenus
adolescents. Il est d'autres jeunes dans le village que j'ai peine à
reconnaître.
